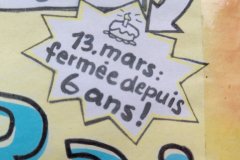Emprises & dépendances – divers – voyageurs
Une aberration
Aux abords de la gare de Cadenet (Vaucluse), lundi 10 novembre 2025
Au cours d’une marche dans Cadenet et de sa gare approchée, bien que devenue habitation privée, je note au passage à niveau n°35 de la ligne de Cheval Blanc à Pertuis (Vaucluse) la présence d’une pancarte écrite en blanc sur fond rouge précisant les indications à suivre par l’usager de la route en cas de dysfonctionnement du P.N., au voisinage direct du téléphone en liaison avec l’agent circulation correspondant. Déjà vu notamment dans le Jura, ce type de pancarte renvoie vers un numéro de téléphone mobile. Je crois me souvenir avoir lu un jour quelque part qu’à terme, les téléphones de P.N. disparaîtraient, renvoyant les usagers de la route vers leurs propres moyens de communication, ce que je trouve discutable. Tout le réseau est-il vraiment concerné ? Cela relève-t-il de décisions locales ou nationales ?
La question sera posée à une connaissance en service aux Télécoms SNCF, m’indiquant devoir retirer ces téléphones pour leur substituer des pancartes avec le numéro des postes d’aiguillage encadrants, précisant que les téléphones ne sont plus fabriqués et que les pièces détachées viennent à manquer. « On marche sur la tête (…) Une aberration », pour le citer ; une de plus, pourrait-on ajouter.
Emprises & dépendances – divers – voyageurs
Aberrations
Paris gare de Lyon et banlieue ouest du réseau Transilien, samedi 1er novembre 2025
Résumé en bref d’une nouvelle « expérience d’achat » d’un billet de train en vue d’une descente en transit à venir dans les Bouches du Rhône alors que je passe par la grande gare de Paris Lyon à une heure d’affluence relative en ce samedi soir : derrière une batterie de bornes libre service, je m’introduis aux guichets Grandes Lignes, d’abord accueilli par une préposée questionnant mon intention ; m’y trouverais-je pour autre chose qu’un billet ou une réclamation ? Une fois passée cette introduction aux allures de formalités administratives au cours de laquelle je découvre que les guichets physiques (humains) ne sont (désormais ?) accessibles que sur rendez-vous, me voilà orienté vers une interface informatique de bureau, certes d’un design différent des BLS extérieures. Mais une fois sur l’écran (évidemment tactile), le cheminement est similaire à celui d’une borne, et seule une référence de billet m’est communiquée, sans édition. Le ticket de carte bancaire n’est manifestement guère plus imprimable (j’espère un simple défaut ou absence de papier). Il me faut donc ressortir avec ma référence en tête et m’orienter vers la première BLS accessible, disponible et en service pour entrer ma référence et daigner me la faire imprimer par la machine.
« Parcours client » ubuesque, donc, résumant toute l’absurdité d’un système commercial d’une pourtant grande entreprise publique sans doute à court d’idées en terme de service clients. Nous sommes perdus, ça se confirme, plus rien n’est fait pour faciliter les choses à personne.
Ce même samedi, tout comme le samedi précédent, la gare d’Austerlitz est privée de RER C en raison de travaux, contraignant donc encore l’usager lambda à recourir à des solutions de contournement quand ce n’est pas de substitution (en l’occurrence, se rendre aux Invalides pour rejoindre l’ouest parisien par train). Et tout comme le samedi précédent, le trafic est complètement interrompu entre Paris Montparnasse et Versailles Chantiers pour travaux (sans commentaire). Parmi les alternatives disponibles, la ligne U depuis La Défense et ses missions modifiées en origine-terminus Rambouillet, mais les rames ne circulent qu’en unités simples. L’allègement du plan de transport conduisant pourtant mécaniquement à un report d’usagers sur ces seuls trains, une exploitation en unités multiples serait pleinement justifiée (déjà signalé par le passé lors d’adaptations similaires du plan de transport). Ils voudraient nous achever et nous pousser vers la route qu’ils ne s’y prendraient pas autrement.
Cet épisode, qui fera l’objet après mon retour d’un nouveau message sous forme de « réclamation » adressé au service client Transilien, fera l’objet d’une réponse quasi automatique n’émanant pas d’un humain (confirmé au vu de l’heure et du jour). Nous y sommes, c’est peine perdue.
Emprises & dépendances – divers – voyageurs
Impuissances
Autour de Limoges Bénédictins, des lignes de Limoges à Angoulême et de Beillant à Angoulême, Charentes et Haute Vienne, septembre 2025
Nouveau départ en vacances et nouvelle virée en région limousine, notamment sur de plus ou moins lointaines traces familiales, que la section de ligne de train encore exploitée de Limoges à Saillat Chassenon me permet d’amorcer en ce début septembre, m’amenant bientôt à fréquenter cimetières et petites mairies rurales, et explorer des terres où je n’ai pas mis les pieds depuis longtemps.
A bord de l’autorail loin d’être complet, horaire et itinéraire finement calculés en raison des contraintes de transport qui s’imposent à l’usager lambda que je suis, le voyage se déroule sans encombre. Chaque arrêt est pour moi l’occasion de chercher à identifier le type de gare de voie unique et les installations attenantes, de noter l’état des emprises, si présence humaine et personnel sédentaire il y a, et autres détails sensibles, me plaçant dans une posture attentive, curieuse et captive du moindre signe d’effritement traduisant l’abandon, peut-être même la perspective d’un funeste avenir (inéluctable ?) de ce qui reste de la ligne de Limoges à Angoulême et de son exploitation bien fébrile.
J’identifie notamment l’embranchement des carrières de Pagnac dont l’agent du poste de Saillat rencontré à mon arrivée me précisera l’activité (bien toujours en service). Par ailleurs, le nombre de passages à niveau et la récurrence de maisons associées d’une forme inhabituelle (cubiques) sur le parcours attire mon attention. A Saillat, l’embranchement de la papeterie n’est plus, et seul un vieux locotracteur à l’arrêt garé dans les emprises de l’usine imposante voisine rappelle le mode ferroviaire par le passé utilisé. J’apprends de l’agent du poste l’intérêt (nouveau ?) que porterait la papeterie pour le rail, sans qu’aucune suite probante de la part de la SNCF ne soit donnée jusque-là (probablement de SNCF Réseau, donc malheureusement sans surprise).
Mes pérégrinations estivales en région m’amènent à surtout circuler véhiculé, transporté tantôt en voitures conduites par des particuliers, tantôt par des cars de la région Nouvelle Aquitaine, avec une appréciation toujours très relative des conditions de transport (accueil limité de certains chauffeurs, fiches horaires contradictoires (mises à jour…), mise en soute de bagages, radios écoutées à bord) et de l’offre (atrophique et atypique) sur l’axe de Limoges à Angoulême via Saillat, dont la gare n’est même pas desservie par la ligne de car « régulière » en correspondance avec les trains…scandaleux ? Assurément déroutant, et un signe de plus du déclassement d’un énième « territoire ». Déclassement et isolement dont les annonces de recherche de médecins et de dentistes affichées à la traversée de certaines communes plus loin se font tristement le relais.
Mon passage en Charente Maritime donne notamment l’occasion de suivre la route reprenant l’itinéraire autrefois emprunté par une branche du réseau des Chemins de fer économiques des Charentes, suivant l’axe reliant Saintes à Mortagne via Gémozac et Touvent, et d’y apercevoir quelques rares vestiges encore présents en bordure de voirie. L’occasion aussi de monter à bord du Train des Mouettes, train touristique à tractions thermique et vapeur, sillonnant notamment à travers champs et marais sur la ligne de chemin de fer reliant Saujon à la Tremblade. Sans marquer un arrêt à toutes les anciennes stations du parcours, le train dessert notamment une commune labellisée « Les Plus Beaux Villages de France » et, pour la partie technique de l’infrastructure, les rails que je remarque sont à double champignon et je note la présence de traverses métalliques. Par ailleurs, la ligne franchit pas moins d’une soixantaine de passages à niveau dont un certain nombre de P.N. à franchissement conditionnel à commande radio sur un parcours d’à peine 21 km, soit une moyenne d’environ trois par kilomètre, ce qui est loin d’être négligeable en terme d’exploitation.

En raison de travaux (encore liés à la mise en place de la commande centralisée de voie banalisée entre Beillant et Angoulême ?), mon retour depuis Saintes me contraint d’emprunter un car, en lieu et place du train jusqu’à Angoulême. Le réseau évolue et les modes d’exploitation changent au gré des grands projets, chaque portion nouvellement raccordée étant un pas de plus vers les commandes centralisées du réseau auxquelles mes convictions personnelles et autres réalités opérationnelles s’opposent toujours pleinement.
Confronté à un écart horaire déconcertant de prime abord une fois à Angoulême pour ma correspondance bus en direction de Limoges, les deux heures devant moi me laissent tout le loisir de visiter plus haut le centre historique et d’y déambuler jusqu’à la statue de Sadi Carnot, avant d’amorcer le retour en passant par les halles. Les abords de la gare n’ont strictement aucun cachet et ne sont pas que bien fréquentés ; j’y suis, comme tant d’autres, désormais tristement « habitué ».
Toujours aussi impuissant face à ce constat et contraint par de nouvelles et désormais récurrentes difficultés pour me déplacer en transports en commun sur mes congés d’été, le tableau n’est cependant pas que noirceur, certaines explorations bien personnelles m’amenant plus tard à suivre quelques itinéraires non prévus (sous la pluie) et autres rencontres m’amenant par exemple une fois à me retrouver invité chez l’habitant (Exideuil sur Vienne).
Ces escapades ne gommeront néanmoins nullement l’état déplorable et sinistré de la gare d’Exideuil dont les lampadaires à crosses courbes semblent regarder, impuissants, la végétation grandissante. Le poste de quai à leviers croupissant dans l’oubli et les emprises largement envahies par la végétation sont caractéristiques de toute section de ligne neutralisée et dépourvue de ne serait-ce qu’une convention d’exploitation à des fins touristiques (vélorail…), freinant plus que jamais ma progression à pied depuis la gare de Roumazières Loubert (impossible et radicalement inenvisageable à cause de la végétation excessive). Roumazières où nombre d’installations de sécurité ont leurs câbles électriques coupés : sabotage interne ? Externe ? Vol ? Dans tous les cas le constat est accablant et ne cesse de noircir mes observations, chaque fois davantage.
On ne veut plus du train. On veut centraliser et densifier ce qui le « mérite » (les métropoles et les « axes structurants »), au détriment du reste, jugé de plus haut comme étant d’une importance moindre. Et on s’étonne ensuite d’orientations politiques dites extrêmes… Combien de temps encore continuerons-nous sur cette voie du mépris ?

Au terme de nouvelles déconvenues de projections d’hébergement, d’horaires d’ouverture d’un musée, et en raison de l’interruption du trafic ferroviaire en heures creuses de journée entre Saillat et Limoges pour travaux (sans commentaire), c’est après deux heures d’attente et sans m’arracher les cheveux que je monterai à bord du mini bus de substitution à destination de Limoges où je passerai finalement deux nuits successives avec une vue imprenable sur la plus belle gare de France. Ce petit séjour me permettra de retrouver la ville, les bords de Vienne, la cathédrale et les jardins, l’architecture et les pavés de rues historiques, le musée du four des casseaux, et quelques brasseries à viande limousine d’où la proximité avec les voies ferrées proches de la gare maintiendra l’immersion ferroviaire par les échos brefs mais répétés des coups de sifflet de trains au passage sur fond de ciel crépusculaire. Si même dans les sombres tableaux, des percées lumineuses restent possibles, les nuances troubles ne sont pas exclues. Mi octobre, justement, le président du conseil d’administration de SNCF Gares & Connexions et président – directeur général de SNCF Réseau, Matthieu Chabanel (alias l’homme qui ne cligne jamais des yeux), félicitera (chaleureusement) le nouveau directeur Général de SNCF Gares & Co’, manifestement convaincu de son rôle à jouer pour « mener à bien les projets innovants qui feront de nos gares des lieux toujours plus connectés, au service des voyageurs et des territoires ».
Je serais curieux de voir se concrétiser ces « connexions » au « service » des tributaires et autres victimes d’aléas de la production ferroviaire, de choix politiques discutables, de réalités sociales troubles et du manque d’optimisation de l’exploitation et de l’infrastructure notamment là où l’effritement de « territoires » délaissés est le plus marquant.
Enfin, le retour depuis Limoges s’étudiera rapidement sur place en reprenant conscience des contraintes actuelles en raison d’importants travaux de renouvellement de la voie dans le secteur d’Orléans empêchant d’envisager un voyage sur la ligne POLT en journée (détestables heures creuses).
Transports sporadiques, dessertes atypiques et inadaptées, interruptions pour travaux, suspensions du trafic pour vétusté, tarifications inégales entre modes, déserts médicaux, détresse sociale, problématiques d’emploi, de logement, solitude et recours à toutes sortes de palliatifs sont des réalités palpables qui donnent le pouls d’une France délaissée. Ni même les mairies de Saillat et de Chabanais ni la région Nouvelle Aquitaine, contactées après mon retour sur quelques sujets (dont transport) ne daigneront me répondre, ne serait-ce que pour accuser réception. L’absence de considération dans ce pays tendrait-elle à se normaliser, à l’image de la brutalité et de la violence préoccupantes d’une certaine délinquance à laquelle nous semblons nous habituer au sein de notre société dont les repères s’effritent sur les voies de la déshérence ?
Emprises & dépendances – divers – voyageurs
Boggie woogie
Sur les traces des anciennes lignes à voie unique de Coutances à Sottevast (section La Haye du Puits – Saint-Sauveur le Vicomte) et de Carentan à Carteret (section La Haye du Puits – Portbail), Manche, fin août 2025
Comme pour compléter la virée de l’été 2024, ce séjour donne notamment l’occasion de cheminer à nouveau aux abords de la voie de Portbail à Barneville et sa charmante petite gare de couleur ocre (cette fois sans train touristique) puis de remonter en selle (location de vélo oblige) pour arpenter la voie verte. La suivre d’abord sur le tronçon commun aux deux anciennes lignes depuis La Haye (ville) vers la bifurcation nord avant de prendre la direction de Portbail permet dans un premier temps de découvrir l’ancienne gare de La Haye du Puits et sa majestueuse halle attenante en réfection.
Chemin faisant, la maison de P.N. n°45 intrigue quelque peu par la présence immédiatement voisine de vestiges d’un semblant de quai se perdant dans la végétation, à droite dans le sens de la ligne. Les recherches ultérieures confirmeront l’intuition (ancien point d’arrêt de Saint-Lô d’Ourville, au croisement de la route de la Gare).
Par manque de temps, le retour depuis Portbail s’envisage par une sortie de la voie verte remontant un chemin de terre, amenant plus loin à traverser la très charmante petite commune de Canville la Rocque pour gagner l’ancienne section de La Haye à Saint-Sauveur le Vicomte à hauteur de Neuville en Beaumont par la maison aux volets verts pastel du P.N. n°47, dont l’arrière jardin intègre discrètement un petit chariot bogie utilisé comme jardinière reposant sur deux files de rails semblant étonnamment spécialement adaptées.

Hormis cette amusante curiosité locale en guise de clin d’oeil ferroviaire, des maisons de P.N. plus ou moins remarquables et quelques détours touristiques notamment à Catteville (et son abri bus/transport à la demande en pierres maçonnées et à toit d’ardoises), les deux sections traversées de part et d’autre depuis La Haye, bien que présentant un intérêt relatif en matière de patrimoine ferroviaire subsistant, laisseront le souvenir d’un parcours agréable à vélo, swinguant entre les gouttes, avec une météo variable caractéristique de cet été décidément bien mitigé au-dessus de la Loire.
Emprises & dépendances – divers – voyageurs
Un monde
Autour de l’actualité d’un article de Reporterre.net au sujet de la réouverture de la ligne de Montréjeau à Luchon (Haute Garonne), août 2025
La réouverture de la ligne, « gérée entièrement par la région Occitanie […] après en avoir obtenu la gestion intégrale auprès de l’État », bien que désélectrifiée, dépourvue de toute possibilité de croisement et de fait, exploitée en navette, apparaît cependant comme une nouvelle bienvenue sur un réseau vis-à-vis duquel le président Farandou lui-même appelle à la vigilance (et aux financements) si l’on ne veut pas voir disparaître un pan entier de son exploitation à moyen terme.
Découvrant cet article de presse par un proche, je m’interroge d’abord sur ce qu’il est sous-entendu par « gestion de ligne », comprenant ensuite le jeu d’appel d’offre pour sa réhabilitation et sa maintenance. Même avec SNCF Réseau, je doute que l’entreprise publique eut envisagé ces travaux avec ses seules équipes, le recours aux prestataires privés étant monnaie courante. Je sais par ailleurs la présidente de région Carole Delga engagée en faveur du rail depuis longtemps, contrairement à d’autres. Au fond, l’important n’est-il pas de promouvoir le mode ferroviaire, dans ce qui nous occupe ici ? Avec ou sans SNCF Réseau.
Comme pour en décourager, les coûts de certains devis annoncés par la branche infrastructure de la SNCF aux régions organisatrices s’intéressant à la réouverture de sections de lignes dites de desserte fine sur leur territoire étant parfois gonflés, je ne suis guère surpris de lire que la « gestion en interne de ces travaux par la région a permis de faire baisser la facture « de près de 30 % » selon Carole Delga ».
C’est un monde… Et parallèlement, la liaison de Guéret (Busseau) à Felletin (Creuse) est menacée, comme écrit plus tôt. Un poids en moins pour SNCF Réseau ?
Au risque de se répéter, les bus, eux, poursuivent leurs rotations, pour le plus grand bonheur des autocaristes qu’une certaine SNCF défendit justement honteusement un temps, sous Guillaume Pepy.
C’est un monde qui fait que je ne pourrai pas plus cet été dépasser en train Saillat, depuis Limoges, la section de ligne jusqu’à Angoulême étant neutralisée, et je ne l’ai découvert qu’il y a quelques mois, songeant alors à mes projections de virées estivales.
La vision économique ou de certains économistes peut faire prendre des chemins différents d’entreprise, me rétorque-t-on ; certes. S’interroger quant à la pertinence de vouloir continuer à faire circuler des trains là où faire circuler des bus coûte, en apparence, moins cher, n’est a priori pas déconnant. Mais c’est négliger plusieurs aspects que certains omettent sciemment dans leur argumentaire :
– Les modes de transport ne sont pas comparés « équitablement » (coûts d’exploitation et d’infrastructure, détaxes, versements de subventions…) ; (absence d’)internalisation des coûts d’infrastructure,
– Les dessertes et globalement le sens du service sont très largement inégaux d’un mode à l’autre (inadéquation d’horaires et de tarifs pourtant parfaitement régionaux avec les besoins de la population dans certains bassins de vie (trains TER) versus horaires et tarifs incitatifs (bus TER et autres cars)),
– L’amortissement du matériel roulant (rames en capacité d’emmagasiner des millions de kilomètres sur plusieurs décennies glissantes versus véhicules routiers au kilométrage plus limité imposant des renouvellements plus fréquents),
– L’accidentologie routière versus ferroviaire…
Comme pour la consommation, si l’offre crée la demande, en matière de transports, l’offre crée la fréquentation. Densifier les trafics pour optimiser l’utilisation des infrastructures a du sens ; le répéter autant de fois qu’il le faudra…
La liste n’est pas exhaustive, la maintenance posant aussi forcément question, les coûts d’entretien d’une rame n’étant sans doute pas à mettre sur le même plan que ceux d’un bus régional, comme les dimensions d’ateliers, par exemple. L’infrastructure et les installations ferroviaires, d’une grande diversité et d’une richesse incontestables, semblent peu évoquées par ailleurs, or il s’agit de patrimoine commun et industriel dont la pérennité et la sauvegarde ne sont pas des détails. Mais il est aussi question de gros sous et de choix politiques (ce qui n’est pas incompatible), d’orientations et de visions dites stratégiques…
Incivilités – malveillance
Boonie
Gare de La Verrière (Yvelines), sur la ligne de Paris Montparnasse à Brest, samedi 26 juillet 2025
Quittant la gare aux alentours de 13h45, m’en éloignant en direction d’un parking distant, deux individus arrêtés échangent à l’ombre du parking vélos en zone encore immédiatement voisine du bâtiment voyageurs. Partiellement ébloui par la lumière du soleil à cette heure ce jour, je ne distingue que le visage du premier homme, semblant bienveillant et compréhensif, et ne me concentre pas sur le visage de l’homme à chapeau de brousse en train de lui parler, et dont il semble adhérer au discours. Au moment exact où je passe devant eux, l’orateur à « boonie hat » hausse quelque peu le ton comme pour m’invectiver plus ou moins directement, scandant de bien douteux propos d’un ton légèrement menaçant, ordonnant aux blancs de faire attention, vantant une forme de revanche par supériorité noire, qu’accompagne une injure…l’homme en question est noir de peau, moi blanc. Cette considération de la couleur de l’épiderme surgit à moi sans que je n’ai rien demandé, « racialisant » de fait « l’autre » dans une ambiance bien malaisante. Pris par surprise et réalisant l’interpellation par cet individu gesticulant quelque peu sur lui-même et dont je crois pouvoir identifier une canette (d’alcool ?) en main, j’ai comme la désagréable impression de me sentir agressé. Par manque de courage ou de détermination pour aller à l’affrontement (qui plus est généralement stérile avec ce genre de personnage), et quelque peu par confusion passagère, je poursuis mon chemin, marmonnant une phrase en guise de régulateur d’humeur, préférant laisser l’importun de côté tout en espérant ne pas le sentir me suivre (sait-on jamais).
Cette « expérience » rappelle l’environnement de cette gare de banlieue parisienne pas que bien fréquentée, invitant par ailleurs à questionner toujours davantage la façon dont ceux s’érigeant systématiquement en victimes contribue à fracturer la société et le « vivre ensemble » pourtant tant promu, jusqu’à certaines organisations politiques douteusement complices ; décidément repoussant.
Emprises & dépendances – divers – voyageurs
Le Re’peyre
Gare d’Aumont Aubrac (Lozère), sur la ligne de Béziers à Neussargues (Cantal), le 11 juillet 2025
C’est à l’occasion d’une remontée par la route depuis les Cévennes que m’est à nouveau donnée à voir la gare d’Aumont Aubrac. En octobre dernier, lors d’une première remontée, j’avais déjà identifié la nouvelle affectation du bâtiment voyageurs sans m’y arrêter ; cette nouvelle traversée de la commune de Peyre en Aubrac permet cette fois de mieux l’approcher. Je n’ai pas mis les pieds dans ses emprises depuis un certain nombre d’années, et si ses abords sont similaires, si l’édicule de quai à cadre jaune d’un goût rappelant l’esthétique douteuse de certaines stations RER franciliennes n’a connu depuis qu’un renouvellement de ses baies vitrées, la guérite en avancée du BV côté voies comme l’enseigne lumineuse porteuse du nom de la gare ont disparu, et une clôture en garde-corps ceinture ce pan de la bâtisse comme pour en éloigner les curieux. Aumont Aubrac n’est donc plus gare au sens de l’exploitation mais un simple point d’arrêt, dont le bâtiment est devenu commerce de produits du terroir dans le cadre du programme 1001 gares (SNCF Gares & Connexions), un programme de soutien au développement économique local et à la revitalisation de gares aux locaux vacants, fonctionnant par appels à projets ; comme simple autre exemple du même programme, un local de la gare du Mont Dore (Puy de Dôme) converti en magasin d’articles de ski il y a des années.
A l’intérieur, je note vite la sensibilité du couple de gérants à l’histoire du lieu : exposés ici et là dans la boutique, accessoires et agrès cheminots (casque, lanterne …), pancartes accrochées aux murs, mais aussi un registre exploitation datant de décembre 1974 à février 1975 et correspondant aux carnets d’enregistrement des dépêches toujours en vigueur dans les postes d’aiguillage du réseau français ! L’échange avec les gérants est des plus cordiaux et, captant mon intérêt, on se livre à moi sur les conditions dans lesquelles l’affaire fut lancée, les travaux, la halle à marchandises utilisée en guise de remise (et d’archives SNCF), comme les quelques difficultés rencontrées, notamment avec la SNCF sur certains aspects du projet. Il en résulte malgré tout un bon exemple à mes yeux de réhabilitation de gare, bien qu’à l’usage détourné, ne reniant aucunement l’histoire du lieu ; salutaire, et soutien à eux : Le Re’peyre.
Incivilités – malveillance
Faire société
Train ROPO de 13h02 au départ de Versailles Chantiers, à destination de Rambouillet, sur la ligne de Paris Montparnasse à Brest, mercredi 28 mai 2025
Outre un certain changement de population étudiante à quai, que de simples observations ne cessent de confirmer année après année, c’est une fois à bord, et dans la continuité persistante des nuisances de celles et de ceux ne voulant pas (ou plus) faire société, que je relève pour la énième fois nombre de sonorités musicales intempestives en provenance de téléphones où chacun y va de ses propres sons, sans la moindre attention à l’égard du voisinage. Si les niveaux sonores seraient probablement jugés modérés par certains (les mêmes qui minimisent tout et n’importe quoi), les nuisances sont pourtant perceptibles, et il semble par moments acté qu’elles fassent malgré tout partie d’une forme de normalité à laquelle nous nous habituons tous plus ou moins, sur une échelle de tolérance néanmoins bien variable…jusqu’à l’explosion ?
Emprises & dépendances – divers – voyageurs
Résidus
Autour de ma visite du poste d’aiguillage de Dreux (Eure et Loir), mardi 20 mai 2025
C’est à l’occasion (choisie) d’une visite des locaux du poste d’aiguillage de technologie dite à transit souple (noter la beauté de la formule) quelques jours avant sa bascule vers un poste tout informatique comme j’exècre qu’un échange avec le dirigeant local au sujet de la section de ligne neutralisée de Dreux à Aunay Tréon (ligne de Chartres à Dreux) renforce ma curiosité : un « gâchis », selon ses dires, que je constaterai dans les heures qui suivent au cours de ma virée exploratoire à Tréon puis Aunay sous Crécy, deux communes mitoyennes fort charmantes, voire bucoliques aux abords de la Blaise.
En guise de descriptif dans le sens inverse de la ligne dont le trafic voyageurs s’arrêta en juillet 1971 : voies à l’abandon mais vestiges intéressants en matière de signalisation (passages à niveau à franchissement conditionnel à commande radio, dispositifs employés par endroits sur voies uniques à trafic restreint à destination de dessertes marchandises), chaîne, poulie et autres supports et guérite de briques et de bois couverte d’un toit de tuiles au P.N. 51, traverses métalliques, pylône d’éclairage sortant du feuillage, câbles tendeurs de poteaux caténaire et voies de service dans la végétation envahissante environnante, quai à marchandises paré de briques et bordé par un vaillant wagon de bois au voisinage immédiat de la gare au charme incontestable d’Aunay Tréon (habitation), poteaux caténaire et fils aériens pendants, quais duvetés d’une herbe verte agréablement printanière, ancien embranchement particulier (ex EP Hurel Arc (produits chimiques, engrais) puis EP Soufflet (céréales)) retourné : résidus de débroussaillement massif (coupe d’arbres), voies déposées, traverses en tas et supports de poteaux caténaire sciés à leur base.
C’est ici clairement terminé pour ce qui sauva un temps ce bout de ligne dont les dernières dessertes se faisaient en mode thermique (trafic devenu restreint puis vol et dépose de fils de contact). Faire et défaire, une énième fois. Mais, n’en déplaise aux détracteurs du chemin de fer et de sa dimension symbolique, pour le visiteur égaré, pour le promeneur lambda comme pour l’explorateur curieux, ces emprises et résidus d’exploitation offrent un espace (oublié) de plus, propice aux errements de l’âme et de la pensée.
Emprises & dépendances – divers – voyageurs
Incivilités – malveillance
Sans fin
Gare de La Verrière (Yvelines), sur la ligne de Paris Montparnasse à Brest, lundi 05 mai 2025
Dans le contexte d’un nouveau mouvement social appelant les roulants de la SNCF à faire grève pour des motifs récurrents et parfois fourre-tout (salaires, cessations anticipées d’activité, emploi (recrutements) et conditions de travail), les usagers des tout premiers trains du matin, à commencer par l’omnibus pour Montparnasse de 04h53 en desserte à La Verrière, se voient très fortement ralentis dans leur progression sur l’ensemble ferroviaire du secteur suite à la pose de pétards sur les rails. Opérée dans la nuit par des individus avisés, la pose de dispositifs détonants impose l’arrêt à toute circulation en rencontrant, avant remise en marche suivant des prescriptions propres aux tractionnaires ou incombant aux aiguilleurs selon la situation, nécessitant plusieurs minutes, notamment en cas de délivrance d’ordre. Pas moins de 6 pétards, implantés de part et d’autre des quais de La Verrière et dans les deux sens de circulation, viennent perturber (pour ne pas dire percuter) de plein fouet le trafic naissant du jour, le secteur de Trappes, gare comprise, n’étant pas non plus épargné par le détournement d’usage de ces dispositifs sécuritaires et ce mode d’action, connu, commis par des individus dont l’appartenance à l’entreprise ne fait planer aucun doute.
En avant gare peu après 06h00, j’aperçois plusieurs usagers rebrousser chemin et remonter en voiture, préférant se rabattre sur la route et tenter d’atteindre au mieux leur destination…
Jean-Pierre Farandou n’a pas tort, il s’agit de faire des efforts, mais partagés. Or certains en interne se foutent assez parfaitement de ce type de recadrage. Aussi j’emprunterais volontiers à une intervenante d’une émission de radio d’opinion la formule suivante : « La SNCF, c’est sans fin »…si ce n’est déjà fini.
Le lendemain, dans le même secteur, une aiguille ne répondra pas au poste d’aiguillage suite à un amoncellement volontaire de ballast empêchant la manœuvre à distance de l’appareil, nécessitant de fait le déplacement et l’intervention d’un agent à pied d’oeuvre, une désorganisation des mouvements et des pertes de temps en sus.
Si ces modes d’action ne dégradent pas directement l’infrastructure, la volonté de nuire à l’exploitation ne fait néanmoins aucun doute, et pourrait malgré tout s’assimiler à une forme de sabotage…c’est sans fin, effectivement, d’autant qu’il n’est pas systématiquement déposé plainte par la SNCF. A suivre…
Emprises & dépendances – divers – voyageurs
Médiation
Gare de Paris Montparnasse, jeudi 03 avril 2025
Arrivé à 23h00 passées en gare avec l’idée (saugrenue ?) d’emprunter l’omnibus de 23h35 à destination de Rambouillet, j’ai, comme d’autres usagers déjà présents, la très désagréable surprise de découvrir que le trafic est interrompu en raison de travaux…sans bus de remplacement. L’agent d’Escale, préposée à l’accueil et déjà identifiée par le passé, seule sur le terrain dans les premiers instants du trouble s’installant, évoque des travaux inopinés depuis lundi, ne manquant pas de faire réagir : d’une part car le caractère imprévu n’est, de fait, pas recevable étant donné que nous sommes jeudi, d’autre part parce que les travaux entraînant l’interruption de trafic étaient manifestement prévus (une impression écran faite plus tard via le site web de Transilien en atteste).
Sur place, aucune communication pour réorienter comme il se doit les voyageurs que nous sommes tous, et un agent maintenant qu’il n’y a ni bus de substitution ni bon taxi, ce qui contractuellement, semble s’apparenter à un dysfonctionnement (d’autant plus que l’information disponible en ligne sur le site de l’opérateur que je découvrirai dans un second temps précise bien la mise en place de bus de remplacement). Au vu de l’attente insupportable d’un bus de nuit Noctilien compatible avec la destination de mon accompagnatrice et moi-même dans un tel contexte dégradé, nous nous rabattons sans tarder sur un transporteur de personnes alternatif aux taxis (trop onéreux).
Compte tenu de la situation, une explication et, si possible, un dédommagement de la part de Transilien (ou d’Ile de France Mobilités si la défaillance du service lui est plus imputable) me semblent alors pleinement justifiés.
Cette déconvenue fera donc l’objet dans les jours suivants d’une première réclamation en ligne au service client Transilien qui n’a décidément de service que le nom (réponses à-côté, formules standardisées, personnalisation proche du néant, clôture du dossier après retour du service client empêchant toute réponse), puis d’une seconde et d’une troisième réclamation pour les mêmes raisons que précitées, déplorant une affligeante absence de considération.
Une première saisine en ligne de la médiation SNCF Voyageurs sera alors déclenchée par mes soins dans la foulée (le 15 avril seulement, compte tenu du temps de correspondance avec Transilien), mais je rencontrerai des contraintes limitatives des plus décourageantes (champs à nombre de caractères limités, copier-coller impossible (à contourner), dispositifs techniques orientés) ; ces moments particulièrement crispants offrant une belle opportunité de contrôle de soi…
M’obstinant malgré tout, au même titre qu’avec le service Client Transilien, il me faudra renouveler deux fois ma demande pour que mon dossier soit enfin considéré et pris en compte, renouvellements successifs pour cause d’inadéquations de pièce(s) jointe(s) concernant le ou les titres de transport, ma saisine étant faite en mon nom pour le compte de deux voyageurs. Rendez-vous dans trois bons mois pour en connaître le verdict.
Nous avons de moins en moins affaire à des personnes physiques et la société se déshumanise continuellement, toutes branches, tous domaines, tous secteurs. Le manque de considération est criant : services clients dont on peut légitimement questionner l’utilité, contraintes techniques en ligne, réponses génériques et parfois foireuses voire carrément raccrochages téléphoniques…jusqu’où irons-nous si nous n’y sommes pas déjà ?
Emprises & dépendances – divers – voyageurs
Creuse encore
Autour de l’annonce de la suspension du trafic sur la section de ligne de Busseau sur Creuse à Felletin (Creuse), sur la ligne de Busseau à Ussel (Corrèze), janvier/mars 2025
Pour y avoir voyagé, la menace de suspension du trafic sur cette section, dont il serait sage de s’interroger quant aux choix opérés depuis des années concernant sa gestion (où la SNCF ne peut être tenue comme unique responsable), confirme de pessimistes projections antérieures (voie de presse, janvier 2025).
Scénario classique de délitement comme d’autres exemples l’ont illustré ailleurs, le cercle vicieux de l’exploitation de ce type de ligne est inévitablement destructeur : amputation par suspension du trafic sur une section (centrale ou d’extrémité), inadéquation des horaires (des circulations comme d’ouverture des guichets jusqu’à leur fermeture), requalification des gares réduites à de simples haltes ou points d’arrêt sans personnel, modifications de plans de voies (dépose d’installations de sécurité et de voies, notamment d’évitement pour croisements), simplification du régime d’exploitation (navette), entretien et maintenance de l’infrastructure limités (budgets et décisions politiques), audits de passage et prononciation du coup d’arrêt redouté.
Sur l’axe nous intéressant, on annonce une suspension pour courant août 2025, et parallèlement, sur la route, les bus et autres cars, eux, poursuivent leurs rotations. Tous les modes de transport ne sont décidément pas logés à la même enseigne…
L’intervention du sénateur de la Creuse Jean-Jacques Lozach questionnant le ministre chargé des transports me semble salutaire, analyse et constat partagés par d’autres observateurs comme l’auteur de Massif Central Ferroviaire qu’il me semble ici parfaitement à-propos de mentionner à nouveau, pointant toujours l’atrophie et la fracture du réseau, pourtant historiquement tissé avec soin pour relier préfectures et sous-préfectures de France (Sauvegarde de la ligne ferroviaire Guéret-Felletin, question orale n°0396S, Sénat, mars 2025).
De la délicate question de la pérennité des lignes dites de desserte fine du territoire et de leur survie ; et un département dont on creuse encore davantage les liens ferroviaires…
Emprises & dépendances – divers – voyageurs
Clarification
Autour de la communication des résultats 2024 SNCF, février 2025
S’il faut encore et toujours le marteler, afin d’éviter toute ambiguïté d’interprétation et toute critique ou dénonciation hâtive, les résultats financiers en question ne concernent pas la seule SNCF ferroviaire mais le groupe SNCF, soit l’ensemble des entreprises le constituant dont Keolis, loin d’être strictement ferroviaires. Dans un contexte où chacun y va de son analyse et de ses certitudes, que des réseaux désociaux alimentent sans retenue, cette précision me semble avoir son importance. Le montant des bénéfices de 1,6 milliard d’euros de l’année 2024 doit donc s’apprécier différemment.
L’augmentation de la fréquentation voyageurs du mode ferroviaire s’observe dans toutes les activités de l’opérateur historique, TER remportant la plus forte hausse, et le chiffre d’affaires croît dans toutes les activités du groupe, transport de marchandises compris malgré l’inscription de Fret SNCF dans le cadre particulier de « discontinuité » de l’entreprise, scindée en deux entités depuis.
Le montant des investissements en faveur du chemin de fer est lui aussi à la hausse, mais gardons à l’esprit la large participation financière de l’Etat et des collectivités territoriales en matière d’investissements, sans négliger non plus la dette de SNCF Réseau qui court toujours, même avec sa reprise partielle par l’Etat.
Emprises & dépendances – divers – voyageurs
Mitigée
Autour de la publication par la Fondation Jean Jaurès d’un texte intitulé « Le fer avec les territoires », une contribution de Jean-Pierre Farandou, président du groupe SNCF, février 2025
S’inscrivant dans la continuité d’une première tribune intitulée « Le fer contre le carbone » en 2022 où le même président adossait sa vision au plaidoyer des compagnies de chemins de fer européennes quant à afficher la volonté commune d’augmenter la part modale du ferroviaire (et donc le report) visant la réduction des gaz à effets de serre (directs), ces nouvelles « Réflexions personnelles sur le rôle du train au service des territoires et de la qualité de vie » émanent d’un auteur en apparence va-t-en-guerre à valoriser le rôle du groupe SNCF (et non du seul ferroviaire, bien que le sous-titre le laisse supposer) en faveur des « territoires » qu’il contribue à soutenir ; soit.
Mais si rendre le rail plus attractif pour les passagers et les chargeurs est louable (« utiliser au maximum le potentiel du rail », dans le plaidoyer européen), la densité de circulations devrait ne jamais cesser d’occuper l’esprit des décideurs, l’offre de transport (et sa fiabilité) étant déterminante pour capter le client potentiel. L’offre est néanmoins encore actuellement bien trop déséquilibrée d’un « territoire » à l’autre et clairement sous-dimensionnée par endroits pour rendre le mode ferroviaire attractif.
L’emploi d’éléments de langage devenus dénués de sens à force de répétition comme « l’expérience de voyage » et la « digitalisation » à marche forcée, notamment de la billetterie et de la réservation dont on ne cesse de vanter les bienfaits de sa numérisation (et du client bon à tout faire en lieu et place de l’opérateur), lassent, d’autant que la tendance des prix et des tarifs des prestations est rarement à la baisse.
La recherche de productivité, sans être fondamentalement dénuée de sens, a cependant ses limites, et une trop grande automatisation consiste toujours davantage à éloigner l’Homme de lui-même : attelages automatiques, plateformes numériques de gestion, exploitation automatique des trains (cantonnement), omettant (à dessein ?) de préciser que l’automatisation comme la « digitalisation » à outrance ne vont pas systématiquement de pair avec efficacité. La présence humaine en autant de gares dites ouvertes au service de la circulation depuis désertées permit par exemple nombre de croisements en régime de voie unique et donc de densifier le trafic, et je doute fort que partout où le block automatique a été installé, l’utilisation du potentiel de l’infrastructure en régime de double voie ait toujours été à son maximum…
Au fil de la lecture de cette nouvelle publication, intention salutaire remarquable, Jean-Pierre Farandou redéfinit des notions et procède de quelques rappels historiques bienvenus : les « territoires » et leur imaginaire collectif, la mobilité et ses enjeux, des dates repères du ferroviaire en France, les futurs services express régionaux métropolitains ou SERM, les principaux types d’organisation du système ferroviaire français que sont le service librement organisé ou SLO (exclusivement commercial, aucune subvention, « yield management ») et le service conventionné en délégation de service public ou DSP, rappelant l’officialisation de leur ouverture à la concurrence.
L’auteur s’attache ensuite à préciser quatre défis concourant à l’aménagement du territoire, attirant l’attention du lecteur sur le risque de paupérisation d’une fraction non négligeable du réseau classique (ce que plusieurs audits et rapports ont déjà pointé par le passé), sur le risque de déséquilibre et de manque de cohérence à venir des correspondances (conséquences à vigiler des nouvelles responsabilités des régions autorités organisatrices et de leurs services de transport ouverts à la concurrence par lots à potentiellement plusieurs opérateurs dont les missions étaient jusque-là remplies par SNCF Voyageurs), puis sur l’hégémonie du transport par route et l’importance du report modal vers le rail (et de propositions pour y parvenir comme imposer de plus fortes contributions au transport routier aux coûts externes et à l’usure de la voirie – bon courage…), enfin sur la péréquation du TGV et les menaces qui pèsent sur ce modèle de compensation entre les liaisons TGV rentables et celles ne l’étant pas (conséquences redoutées du positionnement d’opérateurs ferroviaires autres sur des axes rentables à l’exclusion de tout autre, laissant la seule SNCF Voyageurs en charge des liaisons non rentables).
Au travers de formules aussi diverses et fruitées que « La mobilité est un facilitateur indispensable qui se couple avec la logistique », « rééquilibrage modal » ou encore « une colonne vertébrale ferroviaire décarbonée à la mobilité des biens et des personnes dans l’espace européen », Jean-Pierre Farandou pointe une « urgence du diagnostic » en faveur de l’aménagement du territoire et de la qualité de vie ; manifestement pas exclusivement français ni strictement ferroviaires (« diversité des solutions », « des navettes capables de circuler à la fois sur les rails et sur les routes, les Flexy », « une Europe du rail solide et attractive », « J’ai foi en l’aménagement du territoire (…) Le ferroviaire et le groupe SNCF y ont toute leur place »). L’auteur confirme cependant son « ambition de doubler la part modale du ferroviaire ».
Orientations stratégiques ou simples effets d’annonces, l’avenir nous le dira. On peut néanmoins s’interroger quant à l’« égalité dans la considération des besoins » (selon les dires de Jean-Pierre Farandou) et la diversité des propositions de mise en œuvre, notamment techniques, comme les « projets prometteurs » de voir circuler à l’horizon 2028 et 2029 sur certaines de nos lignes actuellement faiblement circulées de drôles d’engins non alimentés par caténaire au design rétrofuturiste et porteurs de dénominations à l’anglaise…parce que ça fait bien.
A l’instar du programme « Place de la gare » accompagnant le changement d’usage de petites gares s’éloignant de leur mission ferroviaire première, nous assistons progressivement mais activement à des changements d’usage du train et de ses profils. Accompagne-t-on ainsi les changements de société en cours ?
Par ailleurs, faire valoir le renforcement du maillage territorial qu’apporteraient les nouveaux projets de lignes à grande vitesse, pourtant mis en suspens un temps, semble vouloir masquer le maillage d’antan et encore partiellement persistant du réseau classique pourtant enclin à désenclaver lesdits territoires ; question de volontés politiques…et d’entretien du réseau, donc de gros sous et de recours à des prestataires externes au gestionnaire d’infrastructure qu’est SNCF Réseau pour le réseau ferré national.
Si comme l’auteur l’écrit, « la désindustrialisation, les délocalisations, ou encore la fermeture de certains services ont laissé des traces », « chercher à le servir et à lui être utile [territoire] » semble salutaire, d’autant plus en visant le doublement de la part du transport par fer, qu’il soit assuré par l’opérateur historique comme par les nouveaux entrants. Mais y parviendrons-nous vraiment un jour ?
Après sa tribune de 2022 sur la transition écologique, le président du groupe SNCF (loin de n’être que ferroviaire) plaide cependant ici en faveur d’investissements dans le rail, nous partageant ses hypothèses et projections en matière d’aménagement du territoire. Conclusion ? Mitigée.
Emprises & dépendances – divers – voyageurs
Crépusculaire
Sur les traces de l’ancienne ligne de Salins les Bains (Jura) à Levier (Doubs), mercredi 1er janvier 2025
Si ce n’est pas la première fois que je me balade sur le chemin du tracé historique du tacot, ancienne ligne à voie unique à écartement métrique reliant autrefois Salins et Levier, alors exploitée par la compagnie des Chemins de Fer d’intérêt local d’Andelot à Levier, c’est bien une première pour moi que de m’y rendre en plein hiver.
Une toute fin de journée en « errance » en solitaire dans le village de Lemuy et me voilà abordant l’ancienne gare, habitée, mais dont les emprises sont décidément toujours aussi peu entretenues, convoquant cependant un souvenir parfaitement évocateur en référence à une image extraite du très beau film L’aiguilleur, de Jos Stelling, où la silhouette de la gare de montagne écossaise, à l’exploitation en sursis dans le récit, se détache dans l’ombre d’un ciel aussi coloré que ténébreux. Beauté crépusculaire, combien de temps encore ?

Je poursuis ma marche songeuse et tranquille jusqu’à l’orée de la forêt voisine (le Franois), au crépuscule de cette première journée d’une nouvelle année, dont la neige présente et le froid renforcent l’atmosphère poétique.
Le silence qui m’accompagne m’est alors autant bienveillant par la tendresse de sa présence apaisante qu’attristant par l’absence d’êtres chers et les relations perdues dont il se fait insidieusement l’écho. Qui sait si sur le tracé de cette ligne défunte, d’autres silhouettes dansent au crépuscule, s’amusant peut-être de ces questionnements humains sans fin sur les rencontres, le sens de nos existences et leurs troubles chemins ?
Au retour par la route et non la voie, jeudi 02 janvier, c’est depuis l’A6 à hauteur d’Achères la Forêt en Seine et Marne que mon balayage oculaire identifiera furtivement, au sillon formé dans la végétation entre deux champs en contrebas de l’autoroute, un tracé laissant supposer l’existence passée d’une ligne ferroviaire, que mes recherches ultérieures confirmeront, correspondant à la ligne de Bourron Marlotte Grez (Seine et Marne) à Malesherbes (Loiret), dont la section nord est effectivement fermée aux voyageurs et aux marchandises respectivement depuis 1937 et 1950 ; c’est une obsession…